Thomas Hobbes, Léviathan
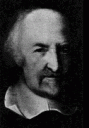 Le texte de Hobbes étudié ici est issu du chapitre 17 de la seconde partie du Léviathan traitant « des causes, de la génération et de la définition de l’ETAT ». De l’anthropologie qu’il a développée durant la presque totalité de la première partie, Hobbes va maintenant déduire un certain nombre de considérations politiques. Parmi celles-ci se trouve la question ici examinée de distinguer les prétendues organisations politiques que l’on observe chez les animaux de celles des hommes. En quoi ces deux modes d’organisations sont-ils semblables et en quoi divergent-ils ? Derrière ce questionnement qui peut paraître incongru à première vue et qui apparaît à un moment dans le texte de Hobbes où il ne semble pas avoir a priori de nécessité, se cache un véritable enjeu : la question de savoir s’il peut, oui ou non, exister un ordre politique naturel. Le projet politique « constructiviste » de Hobbes pourrait en effet être sérieusement remis en cause si l’on parvenait à démontrer qu’il est possible qu’un tel ordre existe. Car pourquoi s’évertuer à montrer les fondements de l’ordre politique si celui-ci existe naturellement ? C’est pourquoi Hobbes va s’attacher à réfuter cette position et à cette fin présenter dans ce texte de 1651 six arguments qu’il avait déjà formulé presque sous cette même forme dans des textes plus jeunes, comme par exemple dans The Elements of Law de 1640. Le texte est ainsi constitué d’un premier paragraphe introductif puis de six autres où sont présentés les arguments, lesquels pourraient être nommés par commodité : l’argument de la raison, de l’égoïsme, de la démocratie, de la rhétorique, du droit et de l’artificialisme.
Le texte de Hobbes étudié ici est issu du chapitre 17 de la seconde partie du Léviathan traitant « des causes, de la génération et de la définition de l’ETAT ». De l’anthropologie qu’il a développée durant la presque totalité de la première partie, Hobbes va maintenant déduire un certain nombre de considérations politiques. Parmi celles-ci se trouve la question ici examinée de distinguer les prétendues organisations politiques que l’on observe chez les animaux de celles des hommes. En quoi ces deux modes d’organisations sont-ils semblables et en quoi divergent-ils ? Derrière ce questionnement qui peut paraître incongru à première vue et qui apparaît à un moment dans le texte de Hobbes où il ne semble pas avoir a priori de nécessité, se cache un véritable enjeu : la question de savoir s’il peut, oui ou non, exister un ordre politique naturel. Le projet politique « constructiviste » de Hobbes pourrait en effet être sérieusement remis en cause si l’on parvenait à démontrer qu’il est possible qu’un tel ordre existe. Car pourquoi s’évertuer à montrer les fondements de l’ordre politique si celui-ci existe naturellement ? C’est pourquoi Hobbes va s’attacher à réfuter cette position et à cette fin présenter dans ce texte de 1651 six arguments qu’il avait déjà formulé presque sous cette même forme dans des textes plus jeunes, comme par exemple dans The Elements of Law de 1640. Le texte est ainsi constitué d’un premier paragraphe introductif puis de six autres où sont présentés les arguments, lesquels pourraient être nommés par commodité : l’argument de la raison, de l’égoïsme, de la démocratie, de la rhétorique, du droit et de l’artificialisme.
Hobbes commence dans le premier paragraphe par admettre qu’il existe des animaux capables d’une vie sociale. « Les abeilles et les fourmis » cités semblent en effet disposer d’une organisation en bien des points comparable à celle des hommes, le tout sans qu’ils disposent du moindre moyen apparent leur permettant de s’accorder sur ce qu’il doivent faire ou non. Ceux-ci sont en effet muets, ne disposent pas de la parole que l’on peut tenir comme un signe évident de la rationalité. Or, l’existence de sociétés politiques formées par des animaux non-rationnels pourrait être une cruelle réfutation des thèses de Hobbes pour qui, rappelons-le, l’Etat procède d’un calcul rationnel des hommes sur ce qui vaut le mieux pour eux en matière de sécurité. Vaut-il mieux être libre mais risquer de mourir à tout instant par le fait d’un autre ? Ou vaut-il mieux passer contrat avec tous pour aliéner une plus ou moins grande partie de sa liberté au profit d’un souverain qui l’utilisera pour faire régner la paix ? Mus par la passion de la crainte, les hommes font appel à leur raison et optent pour le choix de poser les armes. Au contraire, les animaux ne sont mus quant à eux que par ce que l’on pourrait appeler l’instinct. Abeilles et fourmis ne font nullement appel à leur raison, et pourtant semblent vivre dans des sociétés très complexes. Ce sont ces faits qui poussent Aristote, comme nous le rappelle Hobbes, à classer ces animaux comme faisant partie des « animaux politiques », classe à laquelle il fait également appartenir l’homme. La société des abeilles, la société des fourmis procède ainsi pour Aristote directement de l’ordre naturel, tout comme c’est le cas pour celle des hommes : la polis n’est-elle pas comme le prolongement naturel du village, lequel est celui de la famille, laquelle est celui du couple ? Mieux : pour Aristote, l’ordre politique possède à ce point un caractère de naturalité qu’il préexiste même à l’homme. Hobbes est pour sa part à l’exact antithèse, puisque l’Etat n’est pour lui rien de plus qu’un être artificiel qui ne saurait procéder que de la volonté des individus. On comprend dès lors que ces questions de la possibilité d’un ordre politique naturel, de la distinction des modes d’organisation humain et animal sont d’une importance toute critique, et pourquoi il est crucial pour Hobbes de réfuter ces idées.
Le premier argument qu’avance alors Hobbes se base sur le trait principal qui distingue l’homme de l’animal, à savoir la raison. Celle-ci est en effet présentée ici par Hobbes comme une cause de sédition entre les hommes, puisqu’elle pousse les hommes à se comparer les uns aux autres. En effet, comme l’indique Hobbes dans le chapitre 10, la raison sert à évaluer la valeur de chaque homme, c’est-à-dire son mérite; de ce mérite, on en déduit les concepts de dignité et d’honneur. Les hommes étant en « continuelle rivalité » à ce propos, cela engendre nécessairement les passions de l’envie et de la haine, qui sont le terreau de l’état de guerre. Honneur et dignité étant des notions inconnue des animaux, ceux-ci sont épargnés par cette logique qui fait de l’état de guerre une conséquence nécessaire du simple fait que l’homme soit rationnel.
Le deuxième argument prend appui sur le fait que l’homme est essentiellement un être égoïste. L’anthropologie hobbesienne dépeint en effet l’homme comme un être mû par l’amour de soi, par l’amour de sa propre conversation, qui, comme Hobbes l’écrit dans le chapitre 11, est animé « d’un désir inquiet d’acquérir puissance après puissance ». L’homme est obsédé par la satisfaction de ses propres désirs, et la satisfaction de cet intérêt particulier ne saurait conduire à l’intérêt général. Sur ce point, Hobbes, qui est pourtant considéré par certains comme un des fondateurs du libéralisme politique, se sépare de penseurs plus tardifs issus de ce même courant de pensée, comme par exemple Adam Smith, qui se plaçait à l’exact antithèse avec sa théorie de la « main invisible », où l’intérêt général n’est possible que si chacun s’attache à poursuivre son intérêt particulier de manière toute égoïste. Pour Hobbes, homme et animal sont tous deux mus par leur intérêt particulier. Mais pour l’animal, la nature a fait en sorte que celui-ci soit compatible avec l’intérêt général de toute son espèce. Ce qui empêche en revanche les sociétés humaines d’être réglées par le seul intérêt particulier, c’est que chez l’homme, cet intérêt est tout simplement antinomique avec l’intérêt général. En effet, ce que veut tout homme, c’est être « au-dessus du sort commun ». Dès lors, il y a nécessairement contradiction entre l’intérêt de la société et l’intérêt de chaque homme, puisqu’il y a comme un conflit d’intérêt : l’homme ne peut vouloir l’avantage de la société puisqu’il veut être au-dessus de celle-ci.
Le troisième argument est celui que nous avons décidé de nommer l’argument démocratique. La démocratie était en effet définie par Popper et par d’autres comme la seule organisation politique capable de se réformer elle-même grâce à la critique rationnelle des dirigeants à laquelle se doit de participer tout citoyen. Hobbes remarque que tout homme ne peut, il est vrai, s’empêcher de critiquer « l’administration des [de leurs] affaires communes ». Mais là où nous, modernes, verrions un signe de vitalité de la société civile, Hobbes voit un travers, une cause supplémentaire de sédition. Parce que chacun se juge « plus sage[s] que tous les autres », chacun souhaite gouverner, et partant, cela fragmente la société en toujours plus de partis opposés les uns autres. Cette propension à critiquer est là aussi une conséquence direct du fait que l’homme soit un animal rationnel. C’est pourquoi, une fois de plus, ce facteur de trouble épargne les animaux non-rationnels, c’est-à-dire les animaux d’une manière générale.
Le quatrième argument est celui que nous avons qualifié de rhétorique, mais nous aurions tout aussi bien pu le qualifier de platonicien. Platon n’avait en effet de cesse de blâmer lui aussi les rhéteurs, les sophistes, qui usent de la rhétorique, « de cet art des mots » pour « présenter aux autres ce qui est bon sous les apparences du mal et ce qui est mauvais sous les apparences du bien ». De cela, Platon en tirait la conclusion qu’il ne fallait pas abandonner à ces personnes le gouvernement de la cité, qu’il devait revenir aux philosophes. Hobbes quant à lui ne tire de cette remarque rien d’autre que le fait que l’homme soit doué de la parole implique qu’il puisse mentir, tromper les autres, et ainsi « troubler[ant] la paix à son [leur] gré ». L’animal n’a lui qu’un faible « usage de la voix », et n’use de celle-ci qu’à un niveau bien rudimentaire. Si l’on suit en effet la théorie des quatre fonctions du langage de Popper/Bühler, on peut considérer que seul l’homme a accès à la quatrième fonction qui est celle de la discussion argumentée; le reste des animaux est quant à lui cantonné aux deux, voire trois premières fonctions que sont la fonction expressive, signalétique et descriptive. Ainsi, pour Hobbes, ce privilège de l’homme à pouvoir argumenter peut se révéler néfaste à la paix civile en certaines circonstances.
Le cinquième argument est peut-être celui qui est le plus difficile à entendre. Il peut être utile de comparer la formulation qu’en donne Hobbes dans The Elements of Law, qui est assez différente. Hobbes y dit que les bêtes n’ont pas accès au monde du droit où existe de l’injure, mais seulement à celui physique du plaisir et de la douleur (pour faire une nouvelle fois référence à Popper, celui-ci dirait que bêtes et hommes participent tous deux au Monde 1 des réalités physiques et du Monde 2 des états psychiques, mais que seul l’homme a accès au Monde 3 des réalités intellectuelles, telles que le droit). De cela s’en suit que les bêtes ne se préoccupent que de leur seul bien-être physique. Lorsque celles-ci sont à « leurs aises » sur ces points, elles ne peuvent éprouver nulle autre autre offense. L’homme quant à lui aura beau n’éprouver aucun trouble physique, n’être persécuté physiquement par personne, il n’est pas dit qu’il ne puisse pas se sentir offensé du point de vue du droit. Au contraire : c’est même lorsque celui-ci est le plus à son aise, nous dit Hobbes, qu’il trouvera intérêt à se quereller avec les autres. Ainsi, si pour Clausewitz la guerre était la poursuite de la politique par d’autres moyens, on pourrait dire que pour l’homme de Hobbes, la politique, le droit sont la continuation de la guerre sous une autre forme. Remarquons toutefois que dans le Léviathan, ce cinquième argument insiste non pas sur le droit mais plus sur les ambitions politiques que l’homme forme une fois celui-ci parvenu à une relative abondance.
Le sixième et dernier argument vise directement la thèse naturaliste en montrant que le modèle d’organisation politique humain est fondamentalement différent. « L’accord de ces créatures est naturel, alors que celui des hommes … est artificiel ». En effet, a-t-on jamais vu des animaux établir des contrats afin que chacun tienne ses obligations ? Non : si ceux-ci agissent tels qu’ils le font, ce n’est pas par un acte de la volonté libre qui les ferait adhérer à des thèses définies au préalable, mais par ce que l’on pourrait nommer « l’instinct ». Au contraire, s’il y a accord parmi les hommes, ce n’est jamais que par « des conventions ». Or, ce qui est fait par la nature, est difficilement brisable – c’est pourquoi la concorde naturelle qui est entre les animaux peut difficilement être troublée. En revanche, rien n’est plus fragile qu’une convention, et c’est pourquoi la paix entre les hommes, qui n’ont que ce moyen pour pouvoir accorder leurs intérêts, est si précaire. De ce constat, Hobbes en déduit donc la nécessité qu’il faille « quelque chose d’autre, en sus de la convention, pour rendre leur accord constant et durable »; cette autre chose, on le sait, n’est autre que l’Etat. « un pouvoir commun qui [les] tienne en respect et dirige [leurs] action en vue de l’avantage commun ».
Conclusion
Hobbes est-il parvenu avec ces six arguments à briser le naturalisme politique, et à faire triompher le conventionnalisme ? On peut en douter, pour au moins deux raisons. La première est une critique que l’on peut adresser à toute personne qui utilise une foule d’arguments au lieu d’un seul pour démonter la thèse adverse. Pourquoi recourir en effet à six arguments si l’on est si sûr que les thèses du naturalisme soient fausses ? Il aurait été préférable pour Hobbes de ne nous présenter qu’un seul argument robuste. Au lieu de quoi, la multiplication des preuves affaiblit paradoxalement la force de la thèse hobbesienne, tout comme la multiplication des preuves de l’existence de Dieu chez d’autres auteurs finit par convaincre de son absence : si Dieu et le conventionnalisme politique sont à ce point évidents, pourquoi avoir besoin de les prouver ainsi ? Notons que Hobbes semble toutefois avoir établi une hiérarchie entre ses arguments. Attentifs aux règles élémentaires de la rhétorique, il a très probablement choisi de présenter ses arguments dans l’ordre croissant de leur poids, et c’est pourquoi c’est du sixième argument, celui où il oppose frontalement artificialisme et naturalisme, qu’il déduit la nécessité de l’Etat. On peut ainsi dire que ce sixième argument est le seul qui soit vraiment nécessaire à l’économie de la démonstration hobbesienne; les cinq autres étant présents d’avantage pour des raisons rhétoriques que logiques.
La deuxième critique que l’on peut opposer à Hobbes est simplement le constat que ses arguments ne sont pas parvenus à faire taire le naturalisme politique. Celui-ci a survécu à la critique hobbesienne, a poursuivi son existence sous d’autres formes. Citons une des tentatives les plus modernes : celle des Deux sources de la morale et de la religion, où la thèse de Bergson est que, l’habitude étant chez l’homme ce que l’instinct est chez les animaux, les hommes sont capables naturellement de s’organiser socialement (du moins dans les sociétés closes), tout comme les animaux. Nombre d’anthropologues ont de surcroît suivi Bergson sur ce terrain.
Le conventionnalisme a donc toujours le naturalisme pour concurrent. Mais cela suffit-il pour autant à détruire le système de Hobbes ? À l’évidence, non. Les thèses du Léviathan restent d’actualité puisqu’un grand nombre d’entre-elles possèdent leur autonomie propre. Là est le paradoxe de Hobbes : pour prouver ses thèses politiques, cet auteur crut nécessaire de construire un système à la manière des géomètres. On eut pu croire que si une pièce du raisonnement était touchée, tout s’effondrerait comme les châteaux des stoïciens dont parlait Descartes. Il n’en est rien. À croire que le texte du Léviathan soit comme le Léviathan : un Dieu presque indestructible.
[amtap book:isbn=2070752259]

18 décembre 2014 à 23:24 Sarah[Citer] [Répondre]
Merci pour cette explication cela m’a beaucoup aidé!