L’argument d’autorité
 Peut-on à jamais en finir avec les arguments d’autorité du type : « c’est vrai parce que X l’a dit », « je le crois parce que X l’a dit », « X dit le contraire de Y donc je ne crois pas ce que dit ce dernier car moi je ne crois que X » ? Qui emploie ce genre d’argument se voit la plupart du temps disqualifié par l’interlocuteur qu’il pensait convaincre et qualifié de sophiste, au motif qu’un avis n’est pas nécessairement vrai parce que « magister dixit » : d’un point de vue strictement logique, la vérité d’un énoncé est indépendante de l’énonciateur. Qu’une opinion soit professée par Aristote ou proférée par un lambda ne la rend ni plus vraie ni plus fausse, et tout argument de ce type est par conséquent à ranger parmi les armes de la vile rhétorique, et non dans le canon d’une méthodologie scientifique rigoureuse.
Peut-on à jamais en finir avec les arguments d’autorité du type : « c’est vrai parce que X l’a dit », « je le crois parce que X l’a dit », « X dit le contraire de Y donc je ne crois pas ce que dit ce dernier car moi je ne crois que X » ? Qui emploie ce genre d’argument se voit la plupart du temps disqualifié par l’interlocuteur qu’il pensait convaincre et qualifié de sophiste, au motif qu’un avis n’est pas nécessairement vrai parce que « magister dixit » : d’un point de vue strictement logique, la vérité d’un énoncé est indépendante de l’énonciateur. Qu’une opinion soit professée par Aristote ou proférée par un lambda ne la rend ni plus vraie ni plus fausse, et tout argument de ce type est par conséquent à ranger parmi les armes de la vile rhétorique, et non dans le canon d’une méthodologie scientifique rigoureuse.
Mais à bien y regarder, il n’est pas si sûr que l’on puisse se débarrasser si vite des autorités. Il s’agit en fait d’un problème de théorie de l’information. Un constat simple : il est impossible de tout savoir soi-même, de tout lire, de tout vérifier, tel un Pic de la Mirandole qui paraît-il connaissait tout de son époque en son temps (et ce avant même ses trente ans puisqu’il mourra très jeune, empoisonné par les machiavéliques Médicis, sans avoir pu acquérir une Rolex et en ayant donc raté sa vie).
On ne peut pas être spécialiste en tout, et quand bien même on le pourrait, il faudrait au moins un peu de temps pour s’initier. Par conséquent, sur les sujets auxquels on ne connait encore rien mais desquels il faut tout de même avoir un avis pour pouvoir s’orienter (exemple : la politique), on écoute quelqu’un qui sait, un spécialiste, une autorité (un économiste, un sociologue, etc.). On « consulte » : le métier de consultant est une invention de ces dernières années qui ne cesse de se développer ; les entreprises consultent des gens qui savent pour tout sujet.
 Qu’est qu’une autorité du point de vue de la théorie de l’information ? C’est une source d’informations qui émet. Comme toute source, elle est confronté au principe entropique, et il se peut que, de temps à autres, l’information émise par l’autorité soit fausse. Si bien qu’après vérification des informations transmises, on peut établir des statistiques sur la fiabilités des sources. Statistiquement, on fait ainsi plus confiance à une source qui se trompe peu, et on est d’avantage enclin à écouter ce qu’elle dit.
Qu’est qu’une autorité du point de vue de la théorie de l’information ? C’est une source d’informations qui émet. Comme toute source, elle est confronté au principe entropique, et il se peut que, de temps à autres, l’information émise par l’autorité soit fausse. Si bien qu’après vérification des informations transmises, on peut établir des statistiques sur la fiabilités des sources. Statistiquement, on fait ainsi plus confiance à une source qui se trompe peu, et on est d’avantage enclin à écouter ce qu’elle dit.
La valeur de vérité d’un énoncé est indépendante de l’énonciateur et n’est fonction que de la validité de l’énoncé ; mais la valeur de confiance attachée à l’énoncé est quant à elle totalement liée à l’énonciateur, à la source émettrice de l’information. Qu’est-ce que se soumettre à une autorité ? Simplement ceci : sans chercher à savoir si un énoncé est vrai, on va le considérer comme tel (en attente de vérification, mais celle-ci n’est pas nécessaire : on considère à chaque moment un grand nombre d’informations comme vraies sans chercher à les vérifier) si l’on accorde une confiance suffisamment solide à l’énonciateur.
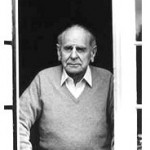 La valeur de vérité d’un énoncé se détermine d’après Popper (Logique de la découverte scientifique, p. 29) en quatre étapes : 1) consistance et cohérence logique interne de la théorie ; 2) recherche de la forme logique de la théorie afin de déterminer si elle est falsifiable et empirique ou bien au contraire tautologique ; 3) comparaison avec d’autres théories rivales afin de déterminer si celle proposée constitue un accroissement de la connaissance si elle s’avérait vraie ; 4) résistance aux tests.
La valeur de vérité d’un énoncé se détermine d’après Popper (Logique de la découverte scientifique, p. 29) en quatre étapes : 1) consistance et cohérence logique interne de la théorie ; 2) recherche de la forme logique de la théorie afin de déterminer si elle est falsifiable et empirique ou bien au contraire tautologique ; 3) comparaison avec d’autres théories rivales afin de déterminer si celle proposée constitue un accroissement de la connaissance si elle s’avérait vraie ; 4) résistance aux tests.
Cependant, lorsqu’il n’est pas possible de procéder à ces quatre étapes (par faute de temps, de moyens, de compétences), la valeur de vérité reste un mystère. Problème : lorsque l’importance de l’énoncé est un enjeu pratique (ou même théorique : on peut ignorer le mystère sur lequel repose le calcul intégral mais le considérer comme vrai et s’en servir) majeur, il faut bien avoir un critère pour savoir si l’on peut s’en servir ou pas, et ce sera la valeur de confiance attribuée à la source.
Comment attribuer cette valeur de confiance ? Comment devient-on une autorité ? Il y a des raisons bien évidemment logiques et rationnelles tout d’abord. X se trompe 1 fois sur 10 alors que Y 2 fois sur 10 ; on peut donc plus faire confiance à X qu’à Y. Ou bien : les énoncés fournis par X sont plus incertains (c’est un astrologue, un psychanalyste ou un philosophe) que ceux de Y (c’est un physicien ou un historien), donc on peut faire plus confiance à Y. Ou encore : l’argumentation de X est plus robuste, moins rhétorique que celle de Y qui est plus métaphysique. Le principe : trouver un critère robuste et rationnel extérieur à l’énoncé considéré, duquel on est bien incapable de déterminer la valeur de vérité, auquel on puisse se fier afin de discriminer ou non l’énoncé.
Mais on voit qu’avec cette méthode, on bute déjà sur un problème. Fonder la valeur de confiance sur un calcul revient à lui attribuer une valeur de vérité ; or, on vient précisément de voir que la valeur de vérité n’était pas toujours déterminable avec toute la rigueur qu’elle mériterait ; si l’on était incapable de déterminer la valeur de vérité de la valeur de confiance (car par exemple on maitrise mal les 19 figures du syllogisme pour déterminer si l’argumentation est solide et le test du khi-deux pour se fixer sur la validité statistique de la source), on devrait alors déterminer une valeur de confiance de la valeur de vérité de la valeur de confiance de la valeur de vérité, si bien que l’on s’embourberait dans les méandres du trilemme de Münchausen.
Aussi stoppe-t-on tôt ou tard la justification par des critères logiques de la valeur de vérité, et on a recours pour établir la valeur de confiance à des raisons extra-rationnelles, extra-logiques qui reposent très souvent sur des critères socio-politiques. Ainsi : X est enseignant, il est écrivain, il a un diplôme alors que Y n’est personne ; X est un homme alors que Y est une femme ; X est un vieux sage qui s’est fait tout seul et Y un jeune con qui est là parce que fils à papa de Neuilly-sur-Seine ; X parle très bien, il présente bien, il a du charisme alors que Y est timide, crasseux et transpire beaucoup ; X est riche alors que Y est pauvre.
 Sur ce dernier point, au sujet de la richesse de l’énonciateur, c’est très intéressant. Marx a contribué à faire admettre l’idée que le contenu idéologique des discours était produit par les conditions matérielles sous lesquelles vivaient les sujets, par leur appartenance de classe. En somme, ce que dit le bourgeois, c’est parce qu’il est bourgeois qu’il le dit, et ça a de fortes chances de n’avoir aucune connexion avec la vérité : s’il le dit, c’est que ça lui profite, que ça permet d’affirmer de manière argumentée son ascendant illégitime sur le prolétaire. Par conséquent, le prolétaire n’a pas à examiner la valeur de vérité d’un énoncé qui sortirait de la bouche d’un bourgeois : il doit simplement le rejeter, car la source n’est pas crédible.
Sur ce dernier point, au sujet de la richesse de l’énonciateur, c’est très intéressant. Marx a contribué à faire admettre l’idée que le contenu idéologique des discours était produit par les conditions matérielles sous lesquelles vivaient les sujets, par leur appartenance de classe. En somme, ce que dit le bourgeois, c’est parce qu’il est bourgeois qu’il le dit, et ça a de fortes chances de n’avoir aucune connexion avec la vérité : s’il le dit, c’est que ça lui profite, que ça permet d’affirmer de manière argumentée son ascendant illégitime sur le prolétaire. Par conséquent, le prolétaire n’a pas à examiner la valeur de vérité d’un énoncé qui sortirait de la bouche d’un bourgeois : il doit simplement le rejeter, car la source n’est pas crédible.
Laissons pour l’instant ce problème, et admettons qu’un énonciateur E ait été autorisé à émettre. Doit-on lui faire confiance ou pas ? On se heurte à de nombreuses difficultés, comme par exemple le domaine de compétence ou l’identité personnelle. Il se peut en effet que E soit très bon dans son domaine de compétence α, mais que parfois, il ose parler sur le domaine β duquel il ne connait strictement rien, mais où il possède tout de même quelques avis (opinions) sur la question. Personne ne sait que concernant β, c’est un bêta, mais chacun sait qu’il se trompe rarement sur α ; par conséquent, il est possible que son indice de confiance, de crédibilité contamine β, et on pourrait prendre pour vrai l’avis d’un géologue lorsqu’il se met à parler de climat. Mais lorsque l’on se rend compte de la supercherie entretenue par E sur le domaine β, son indice de confiance pourrait brutalement baisser à cause des fadaises dites ailleurs que sur α, et lorsque E parlerait à nouveau sur α, on pourrait du coup ne plus le croire, alors qu’il est en fait toujours compétant dans ce domaine.
Du coup, d’un point de vue pragmatique, on peut en tirer une maxime très certaine : mieux vaut se taire que de dire des conneries.
 Ce problème du transfère de compétences pose lui aussi certains problèmes, comme celui consistant à définir strictement un domaine de compétences. Où commencent et s’arrêtent α et β ? Il pourrait même se trouver que certains domaines en englobent d’autres : par exemple, un très bon physicien est nécessairement un très bon scientifique ; cependant, tout très bon scientifique n’est pas nécessairement très bon physicien ; mais peut-être qu’un très bon scientifique sera tout de même meilleur astronome qu’un très bon créateur de mode, si bien qu’il faille mieux croire Hubert Reeves que Paco Rabane au sujet des comètes.
Ce problème du transfère de compétences pose lui aussi certains problèmes, comme celui consistant à définir strictement un domaine de compétences. Où commencent et s’arrêtent α et β ? Il pourrait même se trouver que certains domaines en englobent d’autres : par exemple, un très bon physicien est nécessairement un très bon scientifique ; cependant, tout très bon scientifique n’est pas nécessairement très bon physicien ; mais peut-être qu’un très bon scientifique sera tout de même meilleur astronome qu’un très bon créateur de mode, si bien qu’il faille mieux croire Hubert Reeves que Paco Rabane au sujet des comètes.
Passons au problème de l’identité personnelle. Ce point est tout à fait dépendant du problème du domaine de compétence. Pour le dire en bref : est-ce la même personne qui parle à différent instants, bien que l’énoncé sorte de la même bouche ? Lorsque E parle sur α, il peut être très rigoureux, alors que quand il parle sur β, il se peut qu’il se laisse aller à ses émotions. Le linguiste Chomsky paraît très différent de l’activiste Noam, mais comme c’est le même Noam Chomsky, il y a contamination bilatérale de ses discours, si bien qu’il se peut que certains pensent que l’anarcho-syndicalisme est vrai car la grammaire générative est robuste, et que certains pensent que le nativisme linguistique est faux car ils tiennent l’interventionnisme américain pour nécessaire.
 Mais le problème de l’identité personnelle n’est pas que géographique, au sens où on n’est pas le même en fonction des domaines de compétence (et simplement dans le même domaine, on pourrait peut-être simultanément se tromper et dire vrai à la fois sur deux points tout à fait liés). Il est également historique. En fonction du temps, il se peut que l’on change. Un anthropologue-ethnologue structuraliste très brillant du début du XXe siècle peut se transformer en un vieillard émoussé et grabataire du début du XXIe ; et cependant, on continuera à tenir pour important ce qu’il dit quand bien même il n’y aurait plus aucun sens dans ces propos. Il semble cependant qu’il n’y ait pas contamination rétrospective dans ce cas là. On peut déraisonner tant que l’on veut, cela ne contamine en rien la crédibilité des travaux antérieurs : la syphilis de Nietzsche n’invalide par ses textes d’avant. En revanche, on se montrerait plus circonspect quant à un fou qui retrouverait subitement la raison, aurait vu la vérité et la donnerait à qui veut bien l’entendre.
Mais le problème de l’identité personnelle n’est pas que géographique, au sens où on n’est pas le même en fonction des domaines de compétence (et simplement dans le même domaine, on pourrait peut-être simultanément se tromper et dire vrai à la fois sur deux points tout à fait liés). Il est également historique. En fonction du temps, il se peut que l’on change. Un anthropologue-ethnologue structuraliste très brillant du début du XXe siècle peut se transformer en un vieillard émoussé et grabataire du début du XXIe ; et cependant, on continuera à tenir pour important ce qu’il dit quand bien même il n’y aurait plus aucun sens dans ces propos. Il semble cependant qu’il n’y ait pas contamination rétrospective dans ce cas là. On peut déraisonner tant que l’on veut, cela ne contamine en rien la crédibilité des travaux antérieurs : la syphilis de Nietzsche n’invalide par ses textes d’avant. En revanche, on se montrerait plus circonspect quant à un fou qui retrouverait subitement la raison, aurait vu la vérité et la donnerait à qui veut bien l’entendre.
Ce dernier point est très important. Il montre qu’il y a un passif, un karma de crédibilité que l’on traine avec soi. Il est difficile pour un sot de se racheter et de devenir un génie ; et inversement, il faudra s’acharner, étant un génie, pour devenir crétin. Il semble que s’il y a eu du très vrai, le très faux qui pourrait suivre n’abaisse que très légèrement l’indice de crédibilité ; et que s’il y a eu du très faux, le très vrai qui suit n’élève que très peu ce même indice.
Ce fait est très curieux. Soit un énonciateur E qui aurait dit une quantité x de vrai et une quantité y de faux. Son indice de crédibilité sera plus élevé si x fut chronologiquement dit avant y, plutôt que si y fut dit avant x. On pourrait très certainement le formaliser de manière mathématique, avec des coefficients de pondération.
Contentons-nous d’en tirer une deuxième maxime très pratique : mieux vaut se taire le plus longtemps possible avant de dire une connerie, car c’est la première impression qui compte, et qu’il vaut mieux en premier lieu paraître intelligent.
Ce problème pose également la question des textes de jeunesse non publiés. Nombreux sont les auteurs à avoir accumulé les sottises avant qu’ils ne parviennent à maturité et à la gloire ; souvent, ces textes peu reluisants sont inconnus et cachés ; puis, à la disparition de l’auteur, on redécouvre ces inédits qui stupéfient le lectorat : « comment X a-t-il pu être aussi sot ? » Cependant, dans ce cas là, les travaux tardifs et publiés qui auront valu le succès de notre auteur auront peu de chance d’être invalidés par ces erreurs de jeunesses, alors qu’il y a de grandes chances que si ces erreurs de jeunesses avaient été connues avant les travaux plus sérieux, ces derniers auraient eu beaucoup moins de crédit. Ce n’est donc pas un problème chronologique de genèse d’un esprit que l’on voudrait brillant dès l’origine, mais bien plutôt un problème de découverte par les récepteurs qui accorderont plus de crédit à une source d’information qui émet en premier lieu du vrai, quand bien même du point de vue de celle-ci, elle eut été dans le faux au commencement.
D’où un autre conseil : pour un auteur, une bonne stratégie consiste à écrire une bonne fois pour toute ses œuvres complètes sans en publier une seule, puis à les trier par ordre de pertinence, et ensuite à les distribuer au compte-goutte en commençant par la plus robuste et en terminant par la plus inachevée – en somme, faire l’inverse du principe rhétorique enseignant de finir toujours une démonstration par l’argument le plus fort : paradoxe.
 Un autre problème qui mérite d’être examiné est celui ayant trait à la thèse marxiste sur la corrélation entre appartenance de classe et valeur de confiance. Prenons le cas marxiste du prolétaire P1 qui entendrait un bourgeois B énoncer la vérité V « 2 + 2 = 4 » ; il serait en toute rigueur amené à rejeter cette information indépendamment de sa valeur de vérité, car celle-ci n’a pu être proférée par le bourgeois que parce qu’il désire affirmer son empire, et qu’elle n’est donc pas crédible. Or, voilà que P1 entend un camarade prolétaire P2 affirmer la même vérité V « 2 + 2 = 4 » ; cette fois-ci, P1 tient V pour éminemment vrai puisque la source n’est pas bourgeoise. D’où paradoxe : V ne peut pas être vrai et non vrai à la fois, ainsi que dit Aristote sur le principe de contradiction. Comme résoudre cette difficulté ? P1 pourrait admettre que B a dit, au moins pour cette fois seulement, la vérité. Mais cela invaliderait par conséquent la règle qui voudrait que « B a toujours tort », et qui serait requalifiée en : « il faut considérer ce que B dit comme étant faux, quand bien même cela pourrait être vrai. » Ceci afin de décrédibiliser B, car lui attribuer le pouvoir du dire-vrai, c’est lui attribuer le pouvoir tout court (Foucault). Si
Un autre problème qui mérite d’être examiné est celui ayant trait à la thèse marxiste sur la corrélation entre appartenance de classe et valeur de confiance. Prenons le cas marxiste du prolétaire P1 qui entendrait un bourgeois B énoncer la vérité V « 2 + 2 = 4 » ; il serait en toute rigueur amené à rejeter cette information indépendamment de sa valeur de vérité, car celle-ci n’a pu être proférée par le bourgeois que parce qu’il désire affirmer son empire, et qu’elle n’est donc pas crédible. Or, voilà que P1 entend un camarade prolétaire P2 affirmer la même vérité V « 2 + 2 = 4 » ; cette fois-ci, P1 tient V pour éminemment vrai puisque la source n’est pas bourgeoise. D’où paradoxe : V ne peut pas être vrai et non vrai à la fois, ainsi que dit Aristote sur le principe de contradiction. Comme résoudre cette difficulté ? P1 pourrait admettre que B a dit, au moins pour cette fois seulement, la vérité. Mais cela invaliderait par conséquent la règle qui voudrait que « B a toujours tort », et qui serait requalifiée en : « il faut considérer ce que B dit comme étant faux, quand bien même cela pourrait être vrai. » Ceci afin de décrédibiliser B, car lui attribuer le pouvoir du dire-vrai, c’est lui attribuer le pouvoir tout court (Foucault). Si ![]() veut pouvoir se libérer de l’emprise de
veut pouvoir se libérer de l’emprise de ![]() où
où ![]() , il faut lui ôter tout pouvoir, tout savoir, toute crédibilité.
, il faut lui ôter tout pouvoir, tout savoir, toute crédibilité.
Ce qu’enseigne ce cas (en dehors du fait qu’il est évidemment violemment polémique), c’est que l’indice de confiance n’est pas toujours fonction du seul degré de vérité de l’énoncé – mais cela, on l’avait déjà montré en insistant sur les raisons extra-logiques de l’indice de certitude. L’indice de confiance lie en effet deux termes : l’énoncé et l’énonciateur. Son affaiblissement conduit à l’affaiblissement de l’énoncé, mais aussi à celui de l’énonciateur – et réciproquement, son renforcement renforce l’énoncé et l’énonciateur. Attaquer une autorité, une source d’information revient à attaquer autant les informations qu’elle délivre qu’elle-même en tant que source. C’est donc plus qu’une simple question épistémique qui est en jeu dans l’argument d’autorité : il y a également un enjeu stratégique.
L’argumentum ad hominem consiste à attaquer la source d’information qui a émis un énoncé afin de faire chuter cet énoncé. Tel énoncé est en désaccord avec mes théories ; je décrédibilise son énonciateur afin de rendre faux cet énoncé. Ici, la critique de l’argument d’autorité emprunte le chemin inverse : je veux faire chuter tel énonciateur ; je vais attaquer ses énoncés en les décrédibilisant.
 La critique de l’argument d’autorité est donc bifide : elle peut être faite pour un motif heuristique de recherche de la vérité, mais également dans un dessein éristique de lutte stratégique contre l’énonciateur – tout comme l’est l’argument d’autorité en tant que tel. Qu’en est-il de l’autorité, par-delà ceux qui l’invoquent et ceux qui la réfutent ? Que son indice de confiance s’élève au plus haut ou bien qu’au contraire elle chute au plus bas dépend tant des débats épistémiques de ceux qui la font intervenir que des luttes stratégiques. Elle pourrait être très fausse, mais si ce qu’elle dit est très utile pour l’un des partis, elle pourrait paradoxalement être très solide. Et inversement, si ce qu’elle dit est très vrai mais n’est d’aucun intérêt stratégique pour les acteurs, on pourrait s’en désintéresser.
La critique de l’argument d’autorité est donc bifide : elle peut être faite pour un motif heuristique de recherche de la vérité, mais également dans un dessein éristique de lutte stratégique contre l’énonciateur – tout comme l’est l’argument d’autorité en tant que tel. Qu’en est-il de l’autorité, par-delà ceux qui l’invoquent et ceux qui la réfutent ? Que son indice de confiance s’élève au plus haut ou bien qu’au contraire elle chute au plus bas dépend tant des débats épistémiques de ceux qui la font intervenir que des luttes stratégiques. Elle pourrait être très fausse, mais si ce qu’elle dit est très utile pour l’un des partis, elle pourrait paradoxalement être très solide. Et inversement, si ce qu’elle dit est très vrai mais n’est d’aucun intérêt stratégique pour les acteurs, on pourrait s’en désintéresser.
D’où un dernier précepte (car ce texte commence à être démesurément long) : mieux vaut se préoccuper en premier lieu de prononcer des énoncés ayant des enjeux stratégiques majeurs (sur la politique par exemple) que mineurs (sur l’entomologie), puis en second lieu seulement s’intéresser à leur pertinence épistémique.
Si ce que l’on a à dire est d’une importance stratégique cruciale, d’aucuns n’hésiteront pas dans certains cas à le tenir pour vrai même si cela est faux, et donc à élever l’indice de confiance, et à contribuer à faire devenir la source d’information une autorité. Seul moyen alors pour lutter contre les autorités : en devenir une soi-même, comme c’était le vœu des Lumières.
[amtap book:isbn=2070745376]

3 novembre 2009 à 19:02 luccio[Citer] [Répondre]
Ne supportant pas l’adjectif, et pour te faire mentir, le vieux sage est passé de grabataire à a calenché. Confirmant à qui veut le savoir que tu es un vilain.
Un vilain qui, si le monde est bien fait, se sent coupable. ah ah ah